
L’une des principales craintes qu’instillent à l’ère moderne les médias et les dirigeants politiques, et peut-être plus encore en ce quinquennat Macron qui semble faire ressortir avec une acuité inhabituelle les lignes de fracture de la société française, est celle de l’irruption et du débordement de la violence. Les images réelles et fantasmées de la terreur révolutionnaire, des luttes révolutionnaires armées inspirées du communisme et des camps de concentration sont convoquées dans un joyeux anachronisme —au demeurant fort peu relevé par les intellectuels— qui fait cependant jouer à plein l’imaginaire puissant des souffrances et terreurs les plus absolues de notre inconscient collectif. Les grands ruisseaux de sang sont invoqués, les mises à mort de bébés, les viols, les carnages, les meurtres, la folie. Les khmers rouges, les nazis, le communisme sont semondus à longueur de colonnes et d’éditoriaux.

Cette rhétorique de l’effusion de sang est d’autant plus étonnante que lorsque l’on étudie avec objectivité la réalité de la matérialisation de la violence (en mettant de côté la question des black blocks dont la stratégie consiste précisément à user de l’élément révolutionnaire et des moyens d’action violents dans la rue, avec une efficience somme toute limitée, mais un impact communicationnel démultiplié), on constate que les centaines de milliers de manifestants arborant leurs gilets jaunes ne se sont rendus responsables en tout et pour tout que d’un fenwick1 défonçant une porte et de quelques rares permanences parlementaires taguées ou murées.

En revanche, l’ordre institutionnel est directement responsable de plusieurs dizaines d’éborgnements, de mutilations, et même de plusieurs morts2. La disproportion entre la violence minime des manifestants et la violence extrême de la répression est frappante.

Mais avant d’étudier le rapport de force et le phénomène de la violence dans les contestations démocratiques, il nous apparaît nécessaire de nous pencher sur le concept même de violence afin de l’extraire d’une analyse anthropocentrée sur le XXIe siècle occidendal pour le replacer dans une perspective historico-philosophique plus générale: quelles sont les formes de la violence? Quelle est son influence sur l’évolution humaine? Bien plus, la violence est-elle un processus incident, qu’il est nécessaire à tout prix d’abolir, ou est-ce finalement un processus sociologique structurant?
Il existe, dans la psyché humaine et dans l’Histoire, des lignes de force, des invariants structurants du genre humain, qui viennent du plus profond des âges et ne disparaissent jamais totalement. Au nombre de ceux-ci nous pouvons citer l’amour, la justice, l’honneur, ou encore la violence. La violence est l’un de ces invariants, toujours présent et jamais éteint, protéiforme dans son expression3. La Psyché collective moderne, et ses injonctions héritées de toute une pensée de gauche érigée en réaction au traumatisme de la pensée socialiste poussée vers son aporie sanglante au travers du nazisme, semble refuser l’idée de violence agie. En réalité elle ne fait que déplacer son topos, son lieu d’exercice: du visible vers l’invisible, du réel vers le virtuel, de l’action vers le logos, de la ligne de front à la propagation virale, du physique au psychologique. Cette métamorphose dans l’expression alliant autant la théorisation intellectuelle et les nouvelles formes de contrainte sociales que les techniques algorithmiques du marketing donne l’impression de son effacement, de sa disparition dans ce qui constitue notre âge post-moderne. Or rien ne serait plus inexact. Car ne nous trompons pas. La violence est un noumène fondamental autour duquel s’articule et se construit le développement humain4. De nos jours, le concept est chargé d’émotions négatives, et d’une condamnation immédiate, court-circuitant violemment toute tentative d’intellectualisation, de réflexivité, ou de raisonnement. Cette proscription est cependant étrangement limitée aux formes visibles de la violence agie, physique, et laisse toute licence à la violence psychologique, virtuelle, jamais réellement nommée comme telle5, pour exercer toute sa puissance et influencer des catégories entières de citoyens. La violence archaïque à laquelle se réfère notre cadre de pensée, la violence que l’on pourrait qualifier de « martiale » dont on conçoit l’intérêt pour la protection et la survie de la collectivité autant que la nécessité de sa délimitation stricte au sein de cette même collectivité, disparaît au profit d’une violence anonymisée, désubjectivisée, systémique en ce qu’elle devient une composante fondatrice et métabolisée de la société moderne. La violence peut être bonne comme elle peut-être mauvaise, et la question n’est pas tant de définir sa nature en termes de bien et de mal, que d’étudier la façon dont l’humanité est intimement façonnée par ce noumène, et réévaluer les différentes formes de violence et leurs effets.

Avant que d’étudier les formes de la violence dans la société post-moderne mondialisée, faisons un rapide détour par une approche anthropologique de la violence archaïque de façon à établir si la violence agie n’est, comme la doxa moderne ne nous l’impose qu’une scorie archaïque et incidente dont il convient de se débarrasser, ou au contraire un processus structurant profondément enraciné dans la psyché humaine.
Dans la très riche littérature ethnographique s’attachant à décrire les sociétés primitives de ces dernières décennies, il est rarement question de la violence. Et lorsque par extraordinaire elle se trouve être étudiée, c’est en général pour mettre en scène la façon dont ces sociétés archaïques s’attacheraient à la circonscrire, à la ritualiser, comme si ces sociétés tentaient en anticipant sur la conception occidentale moderne de la réduire, de l’abolir. Lorsque la violence est évoquée dans ces publications, c’est principalement pour faire ressortir l’horreur qu’elle inspirerait aux sociétés primitives, pour conclure que ces sociétés seraient en réalité des sociétés certes obligées de composer avec la violence d’un environnement archaïque, mais comme à contre-coeur, en s’y opposant, en la condamnant. Cette interprétation, qui amène à penser que la violence est extérieure au fonctionnement normal des sociétés primitives, que l’être social primitif se déploie en dehors de l’horizon des conflits armés, est-elle un type de discours sociologique biaisé: une doxa? Une construction idéologique liée aux limites méthodologiques des sciences humaines actuelles, irriguée par la pensée moderne qui avec Hobbes et Rousseau oppose l’état primitif idéalisé d’une guerre de chacun contre chacun à la garantie, là aussi idéalisée, d’une sérénité et d’une pacification des rapports sociaux par la société? Ou relève-t-elle d’une vérité scientifique? Tournons-nous vers l’étude précise de la riche matière des témoignages dont nous disposons afin de répondre à cette question.
Ce que relèvent singulièrement les explorateurs, les missionnaires, les marchands ou voyageurs et savants qui décrivent les mœurs des sauvages qu’ils découvrent du XVIe siècle jusqu'à la fin récente de la conquête du monde, c'est le fait que les peuples « primitifs », qu’ils soient américains, africains, sibériens ou encore mélanésiens soient toujours observés comme étant passionnément adonnés à la guerre. Le caractère belliqueux de ces peuplades étant particulièrement marquant pour les observateurs européens, non pas dans le contexte d’une guerre de tous contre tous, mais dans l’opposition de groupes humains profondément structurés et unis au travers de cette conflictualité même. La guerre délimite la société, et ce qui n’en fait pas partie. La guerre est un cadre structurant.
Des témoignages nombreux et divers rassemblés dans les travaux de recherche surgit en particulier une figure commune invariante malgré l'infinie diversité des cultures décrites : celle du guerrier. Voilà l'impression que recueille la multitude d’observateurs directs qui sous tous les climats, toutes les latitudes, et au long de plusieurs siècles partagèrent pendant de nombreuses années la vie des tribus indigènes et fournirent le riche matériau nécessaire à leur analyse: en tout temps et en tout lieu se rencontre le guerrier. Car en tout temps et en tout lieu, sitôt qu’un groupe humain se structure, ou peut-être devrait-on dire afin qu’un groupe humain se structure, se rencontre la guerre.

Dans son œuvre exhaustive et particulièrement documentée du début du XXe siècle appuyée sur l’ethnologie et la mythologie comparée, intitulée « The evolution of war, a study of its role in early society »6, Maurice Rea Davie montre qu’à de rarissimes exceptions (les Eskimo du Centre et de l’Est), aucune société primitive n’échappe à la structuration par la violence. Il semble donc plus conforme à la méthodologie scientifique de conclure que penser la société primitive équivaut à penser aussi la conflictualité et la guerre comme données immédiates et universelles de la sociologie primitive. À ce titre aucune théorie générale de la société primitive ne peut faire l’économie d’une prise en compte de la guerre, non pas comme évènement incident, contingent, mais comme composante fondamentale de la structure sociale archaïque. En ce sens, évoquons pour les analyser les trois grands types de conceptions incidentes du discours sociologique moderne sur la société et la guerre primitives: le discours naturaliste, le discours économiste, et le discours échangiste.
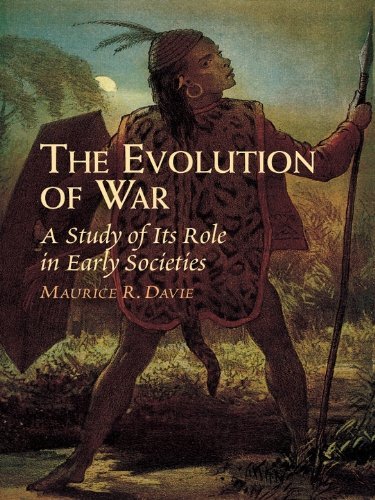
L'évolution de la guerre, ouvrage de Maurice R. Davie
![]()
3 Topology of violence, Byung-Chul Han
4 Et probablement le développement d’un certain nombre d’espèces animales
5 Au mieux, elle est euphémistiquement nommée harcèlement
6 Livre de Maurice Davie sur Google Books
[cryptothanks]En découvrir plus: violence, le discours naturaliste
posté depuis mon blog grâce à SteemPress : https://www.asoka.fr/2019/09/17/la-violence-comme-noumene-sociologique-universel/