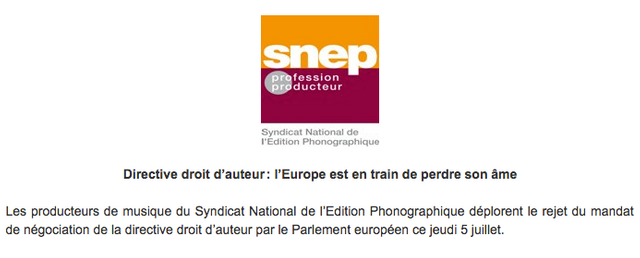
Je reçois hier soir la dernière newsletter du SNEP, le Syndicat National de l'Édition Phonographique qui contient, en tête de liste, ce message aux allures de faire-part de décès.
C'est très intéressant parce que cela fournit une occasion de découvrir la chaîne de métiers qui permet à une chanson de parcourir le long chemin qui va de la tête de son auteur jusqu'au public. Nous y verrons que l'éditeur phonographique n'est absolument pas concerné par « l'article 13 » (encore lui) pour la bonne et simple raison qu'il ne touche aucun droit d'auteur. Bien au contraire, il en paie. Et comme le dit un vieil adage juridique : pas d'intérêt, pas d'action.
Ceci éclaire également les enjeux véritables de la pression actuellement effectuée sur le législateur européen. Ce dernier n'est pas non plus exempt de reproche, le texte de la directive étant par moment très, très flou.
Et tout cela est stupide, désespérément stupide, je te dirai aussi pourquoi.
La chaîne des petits métiers
On serait presque tenté d'ajouter « d'antan »... Voici donc le chemin que parcourt une chanson pour aller de l'idée au public. Il arrive que plusieurs, voire la totalité de ces fonctions soient remplies par une seule et même personne. C'est aussi ce qui empêche de bien comprendre comment tout cela fonctionne. Même les « professionnels de la profession » s'y perdent. C'est pourquoi il est toujours intéressant de considérer les métiers en oubliant les personnes. Reste avec moi, c'est pas hyper long.
1. L'auteur
Je l'ai déjà dit, mais j'aime y revenir, tout commence par l'auteur. C'est la personne qui est à l'origine de l'œuvre. L'auteur écrit une chanson, c'est à dire une mélodie et un texte. Il a juste besoin d'un crayon et d'une gomme. L'auteur est uniquement rémunéré par les droits — d'auteur, justement. Mais pour qu'elle rapporte un peu de sous, il faut savoir exploiter la chanson et ça, l'auteur, c'est pas son boulot. Il se tourne donc vers...
2. L'éditeur musical
L'éditeur musical achète ses droits à l'auteur, il en devient le propriétaire, le plus souvent pour tous les droits, le monde entier et pour toujours. Certains contrats parlent même de « l'univers » comme territoire, au cas où on irait sur mars sans doute. Il va donc toucher une part des droits de l'auteur : définie à 33% par les statuts de la SACEM (qui est la Sté des Auteurs, Compositeurs, mais surtout des Éditeurs de Musique) pour ce qui est des droits issus de la représentation (payés par les personnes qui font entendre directement la chanson au public : organisateur de concert, radio, télé), et selon le contrat passé avec l'auteur pour les droits issus de la reproduction (lorsque quelqu'un est autorisé à faire une copie). En contrepartie de cette cession, il fait imprimer et commercialise une partition à partir de la mélodie et du texte imaginés par l'auteur. C'est historiquement sa fonction première. Mais évidemment, de nos jours, ça rapporte pas des masses car nous ne sommes plus au temps où, la radio n'existant pas, c'étaient les chanteurs de rues et surtout les bals du samedi soir qui faisaient connaître les nouvelles chansons dans toute la France. Il doit donc tout mettre en œuvre pour trouver une voix pour chanter la chanson. Il se tourne alors vers...
3. L'artiste
Aussi appelé artiste principal, car c'est sous son nom que les copies de l'enregistrement de la chanson seront commercialisées. L'artiste ne dispose d'aucun droit sur la chanson, il n'en est qu'un interprète parmis d'autres. Depuis 1985, la Loi lui a cependant prévu des droits, qui ne sont pas des droits d'auteur puisqu'ils ne portent pas sur la chanson elle-même, mais sur sa manière particulière de l'interpréter. On les appelle donc des droits d'interprétation qui font partie des droits dits voisins (car leurs titulaires sont des voisins de l'auteur, sur le boulevard de la gloire). Mais ces droits sont modestes et l'essentiel de la rémunération de l'artiste-interprète viendra des royautés (ou royalties en british, ou redevances selon la terminologie de l'administration fiscale) qui sont une commission sur la vente des copies de ces enregistrements. Et puisqu'on en parle, l'artiste n'a pas les moyens de s'enregistrer, et ce n'est pas son métier. Il doit pour cela se tourner vers...
4. Le producteur
À ne pas confondre avec le réalisateur artistique, traduction de l'anglais producer. Non, chez nous, c'est au sens financier qu'il faut comprendre ce terme. Le producteur étant la personne qui prend en charge tous les frais liés à l'enregistrement. Au regard de la Loi, il est l'employeur de l'artiste-interprète. D'un point de vue strictement économique, le producteur est plutôt un consommateur : il passe son temps à payer. En plus de l'artiste, il paye les musiciens accompagnateurs, le studio d'enregistrement, le matériel éventuellement loué, les techniciens, etc. Ce qu'il achète et dont il est le propriétaire, c'est l'enregistrement fini, celui qu'on appelle la « bande master », l'original qui sort du studio de mixage final et qui va servir de base pour les copies. Tout comme l'artiste, le producteur n'a aucun droit sur la chanson, il n'en est qu'un utilisateur. Et tout comme l'artiste encore, il est titulaire d'un droit voisin, créé aussi en 1985, et qui vient en contrepartie du risque qu'il prend en finançant l'enregistrement. Il lui faut donc faire fabriquer des copies pour les vendre et espérer un retour sur investissement. Il se tourne alors vers le point de départ de ce billet, ah, t'y pensais plus, hein ?
5. L'éditeur phonographique
Ne surtout pas le confondre avec l'éditeur musical qui, lui, vit du droit d'auteur. L'éditeur phonographique est la personne qui, au temps joyeux et révolu du support, prenait en charge la fabrication des vinyles, cassettes et CD. Il n'a aucun droit sur la chanson, il n'est pas propriétaire de l'enregistrement, il est juste propriétaire du stock de copies fabriquées. La loi ne lui a prévu aucun droit d'aucune sorte. C'est au contraire lui qui va payer des droits de reproduction (un peu moins de 10% du prix de vente en gros qu'il compte proposer aux disquaires) en échange de l'autorisation de fabriquer les copies. Charge à lui de les placer dans le commerce (en faisant appel à un autre intermédiaire qui est le distributeur, qui assure la logistique et la force de vente) et, souvent, d'en assurer la promotion conjointement avec le producteur. L'éditeur phonographique, en tant que propriétaire du stock de copies, encaisse le produit de la vente et reverse une commission au producteur.
Et voilà comment une chanson se retrouve dans le commerce, prête à rejoindre ta maison et tes oreilles pour la joie des petits et des grands.
Mais, comment dire... à l'heure du mp3, propriétaire du stock de copies fabriquées... y'a comme un truc qui ne colle plus. Du temps du support, l'éditeur phonographique était celui qui faisait entrer l'argent. Directement pour le producteur et l'artiste interprète et indirectement pour l'éditeur musical et l'auteur, au moment de la reproduction et via la diffusion radio/télé que l'enregistrement occasionnait. Mais ça, c'était avant.
C'est pourquoi les termes choisis par le syndicat de l'édition phonographique ainsi que la forme « faire-part de décès », ressemblent fort à un lapsus révélateur. L'Europe perd son âme ? Tu parles, ce sont surtout les éditeurs phonographiques qui l'ont rendue.
À l'heure du numérique, ils n'ont plus de raison d'être et c'est précisément ça qui est la source de la soi-disant crise du disque, qui en réalité n'existe que dans leur imagination. Pour un marteau, le monde est rempli de clous. Un producteur n'a en effet plus besoin de se tourner vers eux. Un simple fichier mp3 envoyé par mail et l'enregistrement se retrouve en quelques jours — en attendant de pouvoir dire minutes — disponible sur toutes les plateformes.
Bon, d'accord, je joue avec les mots. Le SNEP représente en fait, selon son site, 42 producteurs, dont nombre sont aussi des éditeurs phonographiques. Quarante-deux personnes peut sembler peu, mais ils contrôlent non seulement 80% du marché mais aussi, et surtout, 90% des emplois du secteur, ce qui explique leur poids.
Enjeux d'hier, réalité de demain
Mais quel enjeu défendent-ils ici ? Le texte de la directive précise bien qu'elle s'adresse aux auteurs et aux artistes, performers dans la version anglaise. Il faut savoir que, si l'étude du texte a été remise à plus tard, c'est aussi parce qu'il a été relevé des incohérences profondes entre les traductions, notamment en allemand. Mais ça, personne ne le mentionne... Quand je te dis que c'est un sujet mal compris même des professionnels du secteur, comment un traducteur peut-il s'en sortir du premier coup ?
L'enjeu est la rareté. Les éditeurs phonographiques, par nature, sont des personnes qui ne parviennent pas à imaginer un monde non physique. Ce qu'ils essaient de mettre en place est, si on se rapporte au temps du support, un monde dans lequel tu peux juste écouter un morceau chez le disquaire, mais pas l'emporter chez toi. Franchement, qui serait prêt à payer pour ça ? Personne. Donc, on tente d'imposer au disquaire qu'il paie à ta place, sachant que de toute manière tu n'as pas d'autre possibilité que d'aller le voir pour écouter de la musique. En gros, c'est ça l'idée : étrangler toute source de musique qui serait illégitime à leurs yeux.
Les producteurs/éditeurs phonographiques sont-ils réellement les alliés des auteurs dans cette bataille ?
Carrément pas. L'intérêt d'un auteur ou d'un éditeur musical est qu'il existe autant de versions possibles et imaginables d'une même chanson, peu importe qui l'interprète. Beaucoup de versions = beaucoup d'opportunités de revenu.
Pour l'éditeur phonographique, c'est l'inverse : s'il y a de multiples versions, celle dont il est propriétaire aura d'autant moins de parts du gâteau. Mais contrairement aux éditeurs musicaux, qui sont des professionnels de l'ombre, les producteurs et éditeurs phonographiques ont un accès bien plus facile à l'exposition médiatique, ce qui participe du fait que les auteurs sont les grands oubliés du numérique.
Le seul point sur lequel leurs intérêts convergent est sur la mise en place d'un mécanisme de mesure de la diffusion des œuvres sur internet. Mais toujours avec ce fossé entre eux : les auteurs en ont besoin pour favoriser l'abondance, tandis que les producteurs veulent cet outil pour l'empêcher.
Datagueule
Enfin, revient sans cesse le principe de réalité. Le temps. Or, le temps de l'évolution technique est nettement plus rapide que celui du train des réformes. Le texte mis à l'étude du parlement européen est une directive. Ceci signifie que, contrairement au règlement, il appartiendra à chacun des États membres de l'Union Européenne d'élaborer sa propre loi à partir du texte de la directive. Et cette opération prend du temps. Pour mémoire, la dernière directive européenne sur le droit d'auteur a été prise en 2001 et n'est devenue une loi en France qu'en 2006.
De plus, il y aura des élections européennes en 2019 et, en France, présidentielle et législatives en 2022. Ce sera vite là. Un président souhaitant à priori être réélu se lancera-t-il dans l'examen d'une directive contestée parce que pas du tout en phase avec un pays « start-up » ? Serait-il bon pour son image de se fâcher avec Facebook et Google ? L'ombre de Cambridge analytica et de son influence plane...
En pendant ce temps, les nouvelles plateformes décentralisées se développent, on en parlait encore hier sur Twitter.
Les plateformes décentralisées sont là. Le temps que ce texte soit adopté, elles auront pignon sur rue et le filtrage ne fera qu’attirer créateurs et public vers elles. https://t.co/FE4Y0EEst4
— Patrice Lazareff (@plazareff) 16 juillet 2018
Pour terminer aujourd'hui avec l'une de ces plateformes, je vous présente Choon. Vous pouvez y publier vos chansons, définir le partage des revenus par contrat intelligent, et même en tant que simple auditeur, être rémunéré pour vos playlists en fonction de leur audience.
Les auteurs ont là une chance extraordinaire de construire un avenir serein s'ils ne se laissent pas prendre de vitesse par les éditeurs phonographiques. Mais il faut aller vite. Attendre l'Europe et le prochain président n'est pas une option.